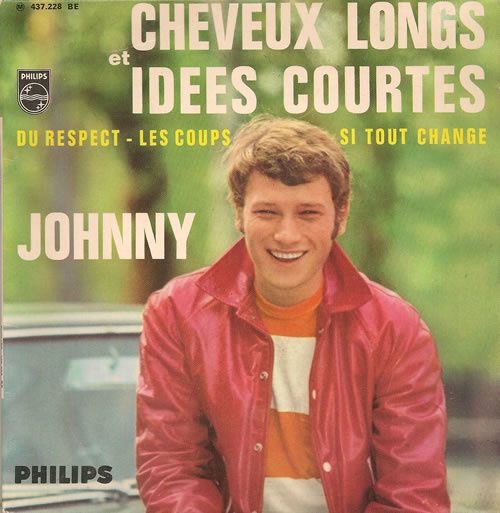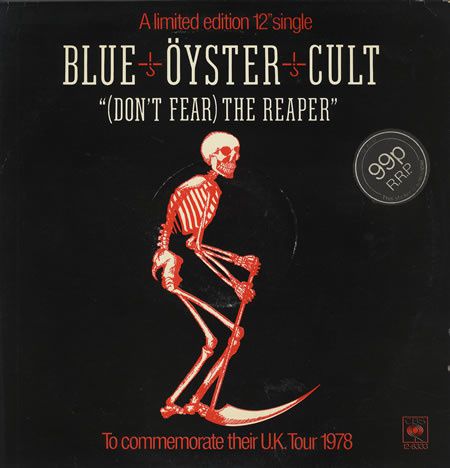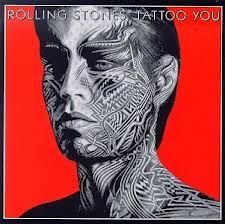Quel plaisir que de se replonger dans l’œuvre foisonnante de l'Américain Robert E. Howard (1906-1936) ! Oui, quel bonheur ! Ce Texan demeure sans conteste l'un des plus extraordinaires raconteurs d'histoires du vingtième siècle ! Même s'il n'a peut-être jamais ouvert le moindre de ses livres, chacun connaît au moins sa création la plus célèbre, à savoir le personnage de Conan le barbare, héros emblématique de la littérature dite d'heroic fantasy... Certes, cette "connaissance" n'est le plus souvent que très relative et demeure généralement pour le moins superficielle, Conan étant un individu autrement plus complexe et tourmenté que ne l'imaginerait celui qui en serait uniquement resté aux illustrations - au demeurant superbes - d'un Frank Frazetta, par exemple. En cela, il s'avère similaire à son créateur...
Car rien ne serait plus contraire à la vérité que d'imaginer un Robert E. Howard malingre, sorte de nerd avant l'heure, se projeter au moyen de l'écriture dans une sorte de monde parallèle afin d'exorciser ses complexes et ses éventuelles frustrations. Non, dans les faits, Howard ressemblait sur bien des points à sa créature, tant par la taille que par la musculature... Il se dégageait de l'homme, un passionné de boxe, une force et une vitalité que l'on retrouve dans son oeuvre, caractérisée avant tout par le mouvement et l'énergie. L'univers dans lequel se débattent ses personnages se situe ainsi à mille lieues de celui, nettement plus gentillet, de Tolkien. Howard se sentait d'ailleurs davantage "conteur d'histoires" que chroniqueur.
S'il est vrai qu'il fut l'ami et le correspondant de Lovecraft (1890-1937), qu'il considérait comme l'un de ses maîtres, on ne retrouve pas chez lui cette peur paralysante du surnaturel. Non, les héros de Howard sont prêts à défendre chèrement leur peau et ne vivent que pour l'action, le combat, contrairement aux narrateurs des nouvelles de Lovecraft, plus cérébraux et fondamentalement incapables d'affronter les événements...
De plus, contrairement à son aîné, Howard vivait très correctement de sa plume et gagnait même, à la fin de sa vie, quasiment autant que l'habitant le plus fortuné de la petite ville de Cross Plains (Texas) où il résidait, à savoir le banquier local. Cette réussite n'empêcha pas celui qui était resté quelque part un petit garçon de se tirer une balle dans la tête après avoir appris le décès imminent de sa mère plongée dans le coma, acte qui mit un coup d'arrêt à l'une des plus prometteuses carrières littéraires de tous les temps...
Malgré cette fin prématurée survenue au cours de sa trentième année, Robert E. Howard n'en laisse pas moins derrière lui une œuvre dense, copieuse et intense... Conan le Cimmérien n'est d'ailleurs que l'arbre, massif, qui cache la forêt des autres personnages créés par l'auteur. Certains, comme l'étonnant puritain Solomon Kane ou le roi atlante Kull ont depuis acquis une certaine notoriété. D'autres, comme Stephen Costigan, ne sont connus que des amateurs. Le cas de ce dernier est d'autant plus intéressant que certains le confondent parfois à tort avec le marin Steve Costigan, héros récurrent de l’œuvre howardienne. Les deux n'ont pourtant pas grand chose en commun.
Stephen Costigan est le protagoniste principal de l'étonnante nouvelle intitulée Skull-Face initialement publiée sous forme de serial dans la mythique revue Weird Tales, d'octobre à décembre 1929. Cette histoire de plus de cent pages fut traduite autrefois par François Truchaud sous le titre de L'Horreur des abîmes et figurait en bonne place dans l'excellent recueil Le Pacte Noir (1). Ces dernières années, Patrice Louinet a proposé de nouvelles traductions des textes de Howard et l'on peut retrouver cette perle dans le recueil Les Dieux de Bal-Sagoth, rebaptisée cette fois Le Crâne vivant (2). Précisons que nous ne connaissons que la version de François Truchaud, étonnamment explicite, et que nous serions évidemment curieux de savoir si la nouvelle traduction se situe dans la lignée de la précédente ou si elle se plie aux exigences du politiquement correct qui prévaut actuellement...
Ne nous voilons pas la face. Il serait sans doute impossible d'écrire, et surtout de publier, une histoire telle que Skull-Face de nos jours (3)... Et, détail hautement révélateur, certains lecteurs actuels de Howard, gênés, se croient obligés de préciser qu'il ne s'agit pas là de leur facette préférée des récits du Texan et qu'ils goûtent assez peu ce type d'aventures. De telles préventions sont non seulement ridicules mais surtout caractéristiques d'une époque aseptisée et peureuse, le pire étant que certains se privent ainsi de véritables moments de plaisir, innocent de surcroît...
Car il s'agit là d'une histoire éminemment distrayante et véritablement jubilatoire. Howard nous plonge dans un Londres sinistre et brumeux, qui rappelle celui dépeint par Conan Doyle, mais on pense aussi à l'atmosphère qui se dégage des textes de Jean Ray, en particulier de certaines enquêtes de Harry Dickson... L'influence de Sax Rohmer est aussi évidente, l'ombre - jaune - du terrible docteur Fu Manchu planant évidemment sur ces pages fiévreuses.
Mais le péril menaçant ici la civilisation serait plutôt noir... Tout commence par une série de troubles, d'abord localisés en Afrique du Sud, puis se répandant sur l'ensemble du continent africain. John Gordon, un agent gouvernemental britannique, sent avec horreur monter les vents de la colère et de la sédition, unissant les Noirs et les musulmans qui ont décidé de chasser les Blancs.
À l'origine de cette révolte, un homme - mais s'agit-il vraiment d'un homme ? - nommé Kathulos. Celui-ci, grand prêtre de la mystérieuse Société du Scorpion, projette ni plus ni moins que la chute des races blanches.
Son but ultime : l'instauration d'un empire noir. Pour atteindre cet objectif, il a été à même de réaliser ce qui semblait jusque-là impossible : l'union des Noirs, des Bruns et des Jaunes.
Kathulos, qui se trouve être le dépositaire d'une très ancienne magie provenant du continent disparu de l'Atlantide, s'attaque maintenant à l'Occident. Son arme principale : la drogue que lui et ses complices ont massivement répandu dans toute l'Europe, afin d'intoxiquer les corps et les esprits et d'asservir des pans entiers de la société. Cela lui a permis de gagner à sa cause des membres de la haute société et nombre de hauts responsables, détenteurs d'importants secrets d'État, sont maintenant à sa botte et couvrent ses activités : "Avant même que le flot noir déferle sur le monde, il aura tout préparé; si son plan se déroule selon ses prévisions, les gouvernements des races blanches seront de véritables nids de corruption..."
Le seul à pouvoir aider John Gordon s'appelle Stephen Costigan, un ancien combattant ayant sombré dans la marginalité et la toxicomanie, habitué des bouges les plus sordides, et devenu l'esclave du maléfique Kathulos. Costigan parviendra-t-il à reprendre son destin en main ? La rédemption de ce misérable junkie est-elle possible ? Qui sait ? L'amour qu'il voue à la belle esclave Zuleika lui permettra peut-être de soulever des montagnes.
L'Horreur des abîmes, une palpitante aventure de John Costigan, qui n'a absolument rien à envier aux exploits de Conan le Cimmérien... Et surtout l'une des oeuvres les plus prenantes de Robert E. Howard.
(1) Aux éditions Marabout.
(2) Aux éditions Bragelonne.
(3) Rappelons que la charmante et innocente bande dessinée Tintin au Congo du talentueux Hergé a fait l'objet, ces dernières années, d'une incroyable et saisissante cabale ourdie par de sombres abrutis.
Tintin au Congo a ainsi été retiré des rayons pour enfants en Angleterre et carrément mis à l'index dans certaines bibliothèques municipales suédoises !
Cette dangereuse BD a aussi été mise sous clef à la bibliothèque de Brooklyn et n'est dorénavant accessible au public que sur demande spécifique !
En Belgique, un certain Bienvenu (pas chez nous) Mbutu (Mobutu ?) Mondodo (ouf !) tenta vainement, avec la complicité active de Louis-Georges Tin, président du Cran (Conseil représentatif des associations noires), de faire interdire ce classique de l'école belge.
Prions donc pour que ces subtils esprits, auxquels nous déconseillons fortement la lecture d'un autre remarquable texte du Texan intitulé Magie noire à Canaan, continuent durablement d'ignorer le nom de Robert E. Howard. Ils seraient bien capables de déclencher un autodafé.
Comme le disait l'excellent Audiard : "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît."